La France doit-elle s’excuser pour la colonisation ? La question posée par les historiens Benjamin Stora et Pascal Blanchard dans leur nouvel ouvrage éponyme, transcende le simple cadre mémoriel. Elle soulève des questions politiques, juridiques et identitaires profondes qui agitent jusqu’à présent l’inconscient collectif français. La France entretient en effet avec son histoire coloniale un rapport complexe, fait de silences, de conflits et d’incompréhensions. Cinq siècles de colonisation pèsent encore lourdement sur les consciences et les débats contemporains. Cet ouvrage qui rassemble les analyses de deux des plus grands experts de cette question, interroge tant la place de l'épopée coloniale dans le roman national que la nécessité de sa transmission.
Un héritage encombrant
Dans un interview exclusive accordée à TRT Français, l’historien Pascal Blanchard rappelle que “La colonisation française ne fut pas un bloc homogène”. Selon ce spécialiste de la question coloniale, elle prend des visages différents selon les territoires et les époques. “Compare-t-on vraiment l’histoire des Antilles avec celle de l’Algérie ? La violence en Kanaky avec celle en Polynésie ? Non. Chaque espace colonisé a vécu une relation spécifique avec l’ex-métropole. Certains ont connu l’esclavage, d’autres le travail forcé, d’autres encore une répression militaire systématique. Cette diversité rend toute approche globale périlleuse”.
Pourtant, un dénominateur commun existe au moment de la conquête ou des décolonisations : la violence. Torture, expropriation, déportation, spoliation culturelle, violence sur les corps, injustice... Autant de réalités qui nourrissent aujourd’hui les demandes de reconnaissance et de réparation.

Crime contre l’humanité : un débat juridique et politique
Faut-il qualifier la colonisation de crime contre l’humanité ? Pour Pascal Blanchard, la question est éminemment juridique. “Contrairement à la traite négrière, reconnue comme telle par la loi Taubira de 2001, la colonisation n’a jamais fait l’objet d’une qualification pénale en France. Bien qu’Emmanuel Macron lui-même, en 2017, lors de sa campagne, avait énoncé une approche globale en reconnaissant que “la colonisation a été un crime contre l'humanité”.
Pourquoi ? Parce qu’une telle reconnaissance supposerait de considérer la colonisation comme un système uniformément criminel. Or, comme le souligne Blanchard, “des députés antillais siégeaient à l’Assemblée nationale durant la colonisation. Des colonisés votaient. D’autres étaient fonctionnaires, militaires, dans les chambres de commerce ou les mairies en tant qu’élus. Cela n’excuse rien, mais complexifie la donne”. L’historien reconnaît, toutefois, que certains actes coloniaux relèvent incontestablement du crime contre l’humanité (selon une approche pénale). Mais l’ensemble ?, ”le débat reste ouvert”, observe-t-il.
Réparer : mais comment, et pour qui ?
La question des réparations est tout aussi épineuse. Pour Pascal Blanchard, cette problématique est quasi-inextricable. “Faut-il des compensations financières ? Symboliques ? Matérielles ? L’Allemagne a versé des fonds à la Namibie pour reconnaître le génocide des Héréros et des Namas. L’Italie de Berlusconi a investi en Libye et Berlusconi a fait des excuses à Kadhafi. Mais l’argent n’est qu’une forme de réparation parmi d’autres (…) Restituer des œuvres d’art, rendre des restes humains, financer des musées, reconnaître publiquement les exactions : autant de gestes qui participent d’une démarche réparatrice. La France a commencé à le faire, timidement. Mais chaque territoire a des attentes différentes. Madagascar réclame des îles. L’Algérie demande des restitutions de biens et de corps. Les Antilles revendiquent une égalité républicaine”.
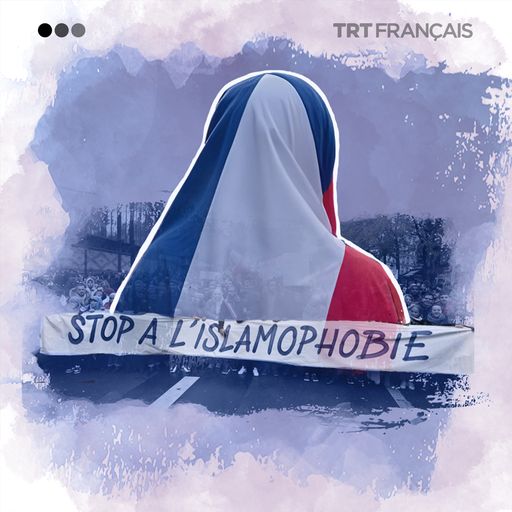
Pour Pascal Blanchard, il n'y a donc pas de réponse unique. La réparation doit être plurielle, comme le furent les formes de la colonisation. Elle doit surtout être à l’écoute des demandes des pays ou populations concernées. La France, par exemple, possède encore les effets personnels de l’Emir Abdelkader que l’Algérie ne cesse de réclamer. Pour que cette restitution ait lieu, une loi devait être votée au parlement au printemps 2024, mais son examen a été repoussé, suscitant l’agacement des autorités algériennes. Mise en place après la visite officielle d’Emmanuel Macron en Algérie en août 2022, la commission mixte des historiens algériens et français n’a effectivement pas résisté aux récentes tensions entre les deux pays : ses travaux ont été, au moins provisoirement, suspendus après la lettre d'Emmanuel Macron adressée au roi du Maroc Mohamed VI, le 30 juillet 2024, où il reconnaît la souveraineté du royaume chérifien sur le Sahara occidental.
En ce qui concerne Madagascar, les autorités françaises ont fait un pas en avant en restituant le 26 août trois crânes datant de l’époque coloniale, dont le crâne présumé du roi Toera, un souverain malgache décapité par l’armée française lors d’un massacre en 1897. Mais la commission sur les événements de 1947 n'a toujours pas été mise en place alors qu’elle avait été annoncée par le président français en avril dernier.
L’Algérie : un cas à part ?
Pour Benjamin Stora, l’Algérie occupe une place centrale dans la mémoire coloniale française. Guerre d’indépendance violente, torture, exode des Pieds-Noirs, immigration massive, situation des Harkis… : les séquelles sont profondes.
Mais résumer la question coloniale à la guerre d’Algérie est trompeur, selon Pascal Blanchard. “La colonisation française ne se limite pas à l’Algérie. Le Cameroun, Madagascar, l’Indochine ont aussi connu une violence extrême. Le napalm fut utilisé au Cameroun. La torture fut pratiquée à Madagascar en 1947. En focalisant uniquement sur l’Algérie, on risque d’occulter l’ampleur du système colonial et donner une lecture déformée de ce passé aux élèves ou au grand public”. Dans ce sillage, Emmanuel Macron a brisé un tabou en août dernier en reconnaissant que la France avait également mené une guerre au Cameroun contre les mouvements insurrectionnels avant et après l'indépendance du pays en 1960.
Pascal Blanchard reconnaît toutefois que l’Algérie reste le point nodal du débat sur la colonisation en France. “Parce que près de sept millions de Français ont un lien familial avec ce territoire. Parce que la guerre a marqué une génération entière (les appelés notamment). Parce que l’État algérien instrumentalise parfois ce passé. Et parce que l’extrême droite française y puise une part de son électorat”.
L’extrême droite, héritière du passé colonial
Le Front national (devenu Rassemblement national) est né dans le sillage de la décolonisation. Son électorat s’est développé notamment (mais pas seulement) parmi les rapatriés d’Algérie, les Harkis et les partisans de l’Algérie française. “Contrairement à d’autres pays européens, l’extrême droite française entretient un lien organique avec le passé colonial” résume Pascal Blanchard.
“Elle cultive la nostalgie d’un empire perdu, l’idée d’une France grande grâce à ses colonies. Eric Zemmour l’écrit tel quel dans Mélancolie Française : le déclin de la France commence avec la perte de l’empire. Cette vision réactionnaire relaie toujours aujourd’hui un récit national glorifié, où la colonisation fut une “mission civilisatrice” (…) Résultat : toute tentative de reconnaissance des crimes coloniaux est perçue comme une attaque contre l’identité nationale. La droite dure rejette la « repentance », brandie comme un épouvantail. Le débat se polarise. La pensée complexe recule” regrette l’auteur de “Sexe, races & colonies” (éditions La Découverte).
Ce constat pessimiste est validé par la nostalgie à peine voilée du RN, aujourd’hui, s'agissant de l'Algérie française et de l’empire. En digne héritière de son père Jean-Marie, Marine Le Pen déclarait récemment sur l'antenne de LCI, que "Venir dire que la colonisation en Algérie a été un drame est historiquement faux et intellectuellement malhonnête”.
« Un immobilisme mémoriel » français
En d’autres termes, la France peine à assumer son passé colonial. Les manuels scolaires ont évolué depuis 30 ans sur le sujet, mais il reste encore du travail de pédagogie à faire et l’État, et certains ministres, freinent des quatre fers sur cette thématique. Pascal Blanchard illustre cet “immobilisme mémoriel” par une anecdote : “Un ancien ministre de l’Éducation nationale lança un jour en off : “On ne va quand même pas raconter à ces enfants ce qu’on a fait à leurs grands-parents”. Cette phrase résume tout. Pourtant, les jeunes générations veulent comprendre. Elles cherchent des réponses dans la culture populaire : le rap, le cinéma, la littérature. Ils lisent des auteurs qui explorent ces pages sombres. La demande est là. Mais l’offre étatique reste faible. La France a choisi l’amnésie. Jusqu’à quand ?”, s’interroge l’historien.
L’ouvrage de Stora et Blanchard ne donne pas de réponse définitive. Il ouvre des pistes. Il invite à penser la colonisation dans sa complexité, sans angélisme ni diabolisation. “S’excuser n’est pas une fin en soi. C’est un début. Celui d’un processus de reconnaissance, de dialogue, de réparation plurielle”. Pour les deux chercheurs, la France doit regarder son histoire en face. Sans culpabilisation, mais avec courage. “Le passé colonial n’est pas derrière nous. Il habite notre présent. Il structure nos rapports sociaux, nos identités, nos conflits politiques. Le comprendre, c’est mieux nous comprendre”, conclut Pascal Blanchard.
























